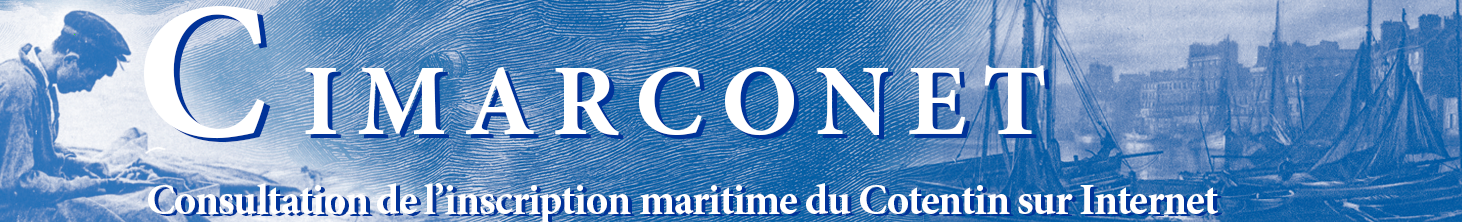Être inscrit maritime dans le Cotentin
1. La carrière d’un inscrit
↑L’Inscription maritime comprend « les marins de tous grades et de toutes professions, ainsi que les mécaniciens et chauffeurs naviguant sur les bâtiments de l’État et sur les navires du commerce. » C’est un décret de 1857 qui avait décidé de soumettre les mécaniciens et les chauffeurs au système de l’Inscription maritime, faisant d’eux, officiellement, des « gens de mer », donc des marins. Ces professions s’étaient développées dans la marine civile dès les premières décennies du XIXe siècle, mais ce n’est qu’en 1856, à la suite de la guerre de Crimée, que la mécanisation totale de la marine de guerre avait été décidée.
La carrière d’un inscrit passe par les étapes suivantes : mousse entre dix et seize ans, puis novice entre seize et dix-huit ans. Ces deux catégories forment les inscrits provisoires : des apprentis marins, en quelque sorte. Puis l’on devient matelot et, donc, inscrit définitif à partir de dix-huit ans révolus. Le service militaire des inscrits est effectué entre vingt et vingt-six ans. Passée cette période de six ans, et souvent plus tôt, car une partie du service était convertie en « disponibilité », les inscrits revenaient dans la marine de commerce ou de pêche, sauf ceux qui avaient choisi d’accomplir leur carrière dans la marine de l’État. Les équipages de la flotte sont aussi recrutés au moyen d’engagements volontaires et d’affectation de conscrits (de l’armée de terre) dans « l’armée de mer ». Les marins réunissant vingt-cinq ans de service dans la marine de l’État avaient droit à une pension complète, égale à la demi-solde de leur dernière paye. Les inscrits de la marine de commerce et de pêche ayant effectué 300 mois de navigation (effective) touchaient une pension, dite également de demi-solde, terme trompeur car ils n’avaient que la moitié de la pension des marins de l’État, qui tournait autour de 7 à 10 francs (des francs « or ») par mois, soit un filet de secours en cas d’invalidité. Vers l’âge de 50 ans, tous ces marins deviennent des « hors service », ce qui ne les empêche pas de mieux gagner leur vie en pratiquant la petite pêche. Leurs retraites sont toujours financées par une caisse autonome qui prélève 3,5 % sur les salaires des inscrits.
2. L’exemple de Jean Moitier
↑Jean Moitier n’est pas un personnage célèbre : il n’a accompli aucun exploit, ne s’est nullement distingué dans ses actions, n’a laissé aucun souvenir dans l’histoire de sa région, ni même de sa ville. C’est un anonyme, un obscur, un humble, qui n’aurait pas laissé d’autres traces que deux ou trois mentions dans les registres de l’état civil de Saint-Vaast-la-Hougue, où il naquit et mourut, s’il avait été, comme beaucoup de ses voisins, un paysan ou un artisan. Mais Jean Moitier était marin de son état et comme tel, il a été enregistré dans les matricules de l’inscription maritime du quartier de la Hougue : aussi toute la vie de ce marin obscur peut-elle refaire surface et nous être révélée.
La reconstitution de cette histoire n’est cependant pas aisée, car les matricules ne se livrent pas facilement : il faut pour le chercheur allier patience et logique pour en dévider le fil et jongler avec les registres pour en retirer la substantifique moelle. En effet, un seul registre ne donne pas accès à toute la carrière d’un marin : comme ils sont tenus par tranches chronologiques, ils sont périodiquement révisés et l’on transfère alors les dossiers de chaque individu dans un nouveau registre avec un système de renvois pour faire le lien entre les deux. De plus, à l’intérieur de chaque tranche, la carrière du marin n’est pas linéaire : il peut d’abord être mousse, puis novice, inscrit provisoire et inscrit définitif, enfin hors de service. A chacune de ces catégories correspond un type de registre, matricule des mousses pour enregistrer les mousses, matricules des novices pour enregistrer les novices, etc. Dans le cas de Jean Moitier, il ne faut pas faire appel à moins de sept registres, correspondant à quatre tranches chronologiques, trois types de matricules (novices, matelots et hors de service) et neuf cases matriculaires différentes pour reconstituer le fil de son existence.
Que nous apprennent ces cases matriculaires ? Des éléments d’état civil, tout d’abord : Jean Moitier est né à Saint-Vaast le 15 mai 1789 des œuvres de Jacques-Nicolas Moitier avec Geneviève Le Toupin. Il a épousé plus tard Catherine Mignot et avait quatre enfants à la date du 1er août 1829. Il est mort à Saint-Vaast le 16 mars 1862.
Il s’agit là d’éléments très banals qu’on pourrait retrouver dans n’importe quel registre d’état civil. Un élément plus intéressant en revanche, même s’il est anecdotique, c’est qu’à défaut de photographie ou de portrait, les matricules livrent son signalement complet : il mesurait 1,63 mètres, avait les cheveux et les sourcils châtains, des yeux gris bleu, le front et le menton ronds dans un visage ovale, avec un petit nez et une grande bouche.
3. Jean Moitier : la vie d’un marin au fil des matricules
↑Ce qui fait l’importance des matricules, ce ne sont pourtant pas ces renseignements, aussi précieux soient-ils. C’est surtout le relevé patient et complet réalisé par l’administration de tous les embarquements du marin, qui permet de reconstituer, non seulement les grandes étapes de sa carrière professionnelle, mais encore tous les détails de celle-ci.
Embarqué comme novice à l’âge de dix-huit ans (23 décembre 1807), Jean Moitier est fait prisonnier par les Anglais le 19 décembre 1809 alors qu’il naviguait comme matelot à 24 livres sur la corvette le Papillon. Il n’a alors que vingt ans et demeure prisonnier à Portsmouth jusqu’à son rapatriement à Cherbourg le 20 mai 1814, après la première abdication de Napoléon et la paix avec l’Angleterre. Tel est le seul lien de Jean Moitier avec la « grande histoire » et celui-ci lui valut plus de quatre années de captivité.
Revenu au pays, il s’embarque moins d’un an après, le 7 février 1815, comme matelot sur de petits bateaux de transport puis et surtout pour la pêche au maquereau. C’est le début d’une longue carrière de marin pêcheur de près d’un demi-siècle, rythmée par les embarquements et les débarquements, les campagnes de pêche au maquereau ou aux huîtres et celles au cabotage. Toutes sont consignées dans le détail au long de ses cases matriculaires et, au travers de celles-ci, c’est tout l’univers du monde des marins de Saint-Vaast qui est recréé. A peine quelques semaines à terre, et c’est à nouveau le départ. Pendant près d’un demi-siècle, Jean Moitier mène cette vie rude, comme matelot puis, tardivement à partir de 1859, comme patron pêcheur. Deux ans plus tard, le 2 mai 1861, c’est l’ultime débarquement et la retraite à Saint-Vaast. Il n’en profite d’ailleurs guère puisqu’il meurt moins d’un an après dans sa soixante-treizième année.
Ils sont des centaines, des milliers de Jean Moitier, couchés dans les registres de l’inscription maritime. Reconstituer ces milliers de carrières, ressusciter tous ces anonymes présente un double intérêt : pour le généalogiste tout d’abord, c’est une source d’une richesse inégalable puisqu’elle fait revivre année par année son ancêtre ; pour l’historien ensuite, elle n’est pas moins importante puisque de l’étude comparée de ces carrières, de la confrontation de ces données, naît une vision précise du monde maritime sur les côtes de la Manche dans sa composante essentielle, l’aspect humain.